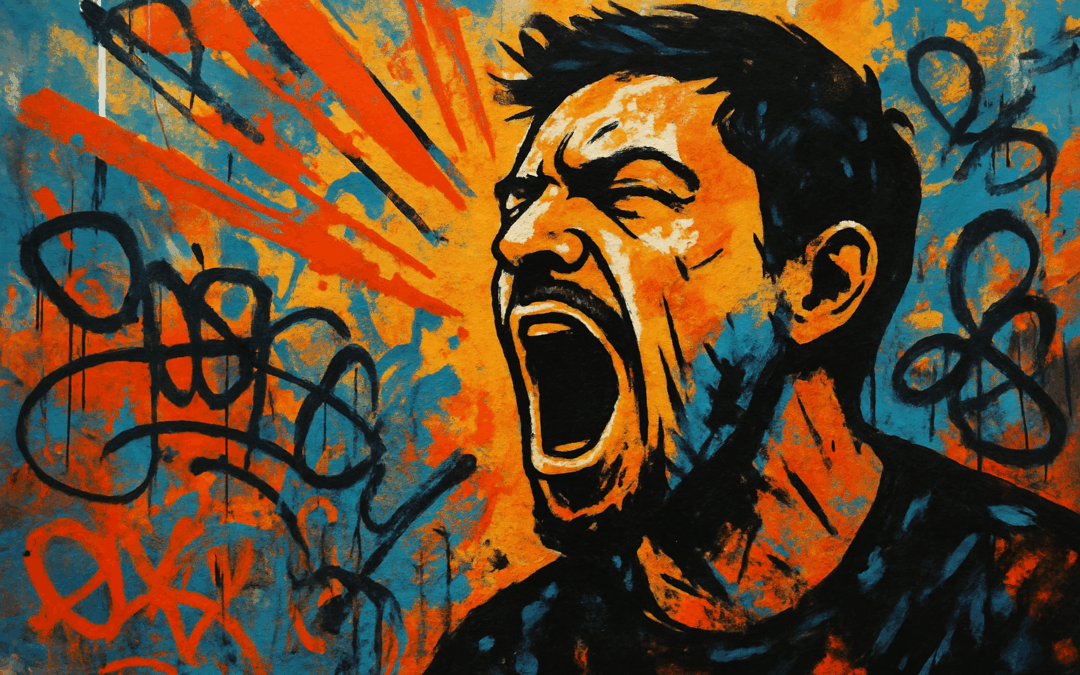Fiscalité : l’excès idéologique
La fiscalité française vient de franchir un nouveau cap. En effet, l’Assemblée nationale a voté un amendement élargissant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à ce que certains qualifient d’« actifs improductifs ». Parmi eux : les fonds euros de l’assurance vie. Une décision aussi symbolique que risquée.

Les français en dépression fiscale
Une cible mal choisie
Les fonds en euros ne sont ni des placements spéculatifs, ni de simples matelas d’épargne. Ils représentent une part centrale du financement de l’économie française. Ainsi, chaque année, les milliards collectés via ces contrats alimentent les obligations d’État. En d’autres termes, les fonds euros permettent à la France de financer sa dette à long terme.
En somme, taxer ces véhicules revient donc, indirectement, à pénaliser une source majeure de financement public. Une contradiction que les promoteurs de cette mesure semblent ignorer.
Une logique idéologique
Ce glissement fiscal s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’une vision égalitariste de l’impôt, plus morale qu’économique. L’IFI, créé pour cibler les grandes fortunes immobilières, se voit aujourd’hui instrumentalisé pour atteindre tous types de patrimoine perçu comme passif ou dormant.
Mais à trop élargir le champ de l’IFI, le risque est grand de saper la confiance des épargnants. Effectivement, ceux-ci pourraient être tentés de désinvestir des produits pourtant essentiels à l’équilibre du système financier français.
L’épargne, bouc émissaire
En France, l’épargne est régulièrement montrée du doigt. Jugée conservatrice, peu utile à l’innovation, voire suspecte sur le plan moral. Décriée, elle devient la cible préférée d’un certain discours politique.
Pourtant, l’épargne longue, comme celle que représente l’assurance vie, permet de lisser les risques sur le long terme. Elle garantit une certaine stabilité financière aux ménages et aux institutions.
De ce fait, l’attaquer frontalement, au nom d’une supposée justice fiscale, revient à fragiliser l’un des piliers du financement national.
Confusion entre productivité et spéculation
Le terme « improductif » utilisé par les députés pour justifier l’élargissement de l’IFI prête à confusion. Car de quoi parle-t-on exactement ? D’actifs qui ne créeraient pas directement de valeur ? Ou d’actifs qui ne seraient pas assez risqués ?
Les fonds euros sont composés majoritairement d’obligations, souvent souveraines. Leur rendement est modeste, mais stable. Ils n’ont pas vocation à générer de la croissance rapide, mais à sécuriser l’épargne.
En conclusion, ce sont donc des produits de stabilité, non de spéculation. Les considérer comme improductifs relève d’un contresens économique.
Une attaque contre l’assurance vie
L’assurance vie reste le placement préféré des Français. Elle représente plus de 1 900 milliards d’euros d’encours. Et sur ces presque 2 000 milliards, près des deux tiers sont investis en fonds euros. Aussi, non seulement cette manne est stratégique pour l’État, les banques, les assureurs, mais elle l’est également pour les entreprises et les collectivités.
Toucher à cet équilibre revient à désorganiser toute la chaîne du financement. Pire encore : c’est envoyer un signal négatif à ceux qui, par prudence, ont choisi l’assurance vie pour préparer leur retraite, protéger leur famille ou simplement sécuriser leur capital.
Les conséquences pratiques
Sur le court terme, les épargnants risquent de fuir les fonds euros pour se réfugier dans les unités de compte, plus risquées mais épargnées par l’IFI. Résultat : l’assurance vie luxembourgeoise, déjà très prisée, devrait continuer d’attirer les capitaux. Avec, à la clé, une épargne plus volatile et des flux moins prévisibles pour l’économie française.
À moyen terme, la collecte nette des contrats en fonds euros pourrait s’effondrer, privant l’État d’une source de financement obligataire régulière et peu coûteuse. Le coût de la dette publique pourrait alors mécaniquement augmenter.
À long terme, c’est le pacte implicite entre l’État et les épargnants qui serait rompu. Or, ce lien de confiance est essentiel, surtout dans un pays où la pression fiscale est déjà l’une des plus fortes d’Europe.
Une fiscalité à revoir
Plutôt que de multiplier les exceptions, niches ou élargissements hasardeux, la fiscalité du patrimoine aurait besoin d’une refonte complète. Aujourd’hui illisible, elle cumule les logiques contradictoires. Par exemple, inciter à l’investissement productif tout en pénalisant l’épargne stable.
Pourtant, une fiscalité claire, lisible, avec des règles stables dans le temps, serait bien plus efficace pour orienter l’épargne vers les bons supports. L’instabilité actuelle dissuade les investisseurs, notamment étrangers, de placer leur argent en France. D’autre part, elle donne à un grand nombre d’épargnants français la préférence du Luxembourg.
Une mesure contre-productive
Finalement, sous couvert de justice fiscale, l’élargissement de l’IFI à certains actifs improductifs risque d’avoir l’effet inverse de celui recherché. Loin de faire contribuer les grandes fortunes, elle pourrait fragiliser les classes moyennes. Autrement dit, celle qui constitue le cœur de l’effort d’épargne national.
En réalité, cette mesure revient à punir les comportements prudents et rationnels. En effet, elle encourage la prise de risque au détriment de la sécurité, dans un contexte économique où l’incertitude domine.
L’urgence d’un débat de fond
Le débat fiscal mérite mieux que des coups d’éclat idéologiques. Il nécessite une vision à long terme, fondée sur des faits économiques, non sur des slogans.
Avant de redessiner les contours de l’IFI ou d’inventer de nouveaux impôts, il faut s’interroger sur les objectifs véritables de notre système fiscal. Est-il là pour redistribuer ? Financer l’État ? Orienter l’investissement ? Favoriser la stabilité sociale ?
Sans réponse claire à ces questions, chaque nouvelle mesure ne fait que renforcer le sentiment d’arbitraire et d’illisibilité.